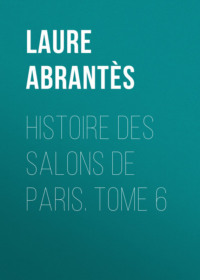Buch lesen: "Histoire des salons de Paris. Tome 6"
SALON DE M. DE TALLEYRAND,
SOUS LE DIRECTOIRE, LE CONSULAT ET L'EMPIRE
PREMIÈRE PARTIE
LE DIRECTOIRE ET LE CONSULAT
C'est un homme difficile à suivre dans les méandres de sa vie politique que M. de Talleyrand… Cette destinée, se présentant toujours différemment qu'elle ne doit se terminer, a quelque chose d'étrange qui surprend, et empêche quelquefois d'être aussi impartial qu'on le voudrait pour juger un homme dont l'esprit est si supérieur et si remarquable d'agréments, comme homme du monde: c'est qu'il est en même temps homme de parti; on ne peut pas les séparer: et si l'un attire, l'autre repousse.
Avant la Révolution, l'abbé de Périgord était un abbé mauvais sujet; il faisait partie, à peine sorti du séminaire de Saint-Sulpice, de l'état-major religieux de l'archevêque de Reims. On sait que cette troupe d'abbés était la plus élégante et la plus recherchée parmi tous les jeunes gens qui prenaient le parti de la carrière ecclésiastique1. L'abbé de Périgord ne fit faute à sa renommée, et sa conduite répondit parfaitement à ce que les autres avaient annoncé. Mais M. de Talleyrand, dès cette époque, annonçait, lui, un homme supérieur à tout ce qui l'entourait… Et cette universalité dans les goûts, cette facilité dans tout ce qu'il faisait, prouvaient par avance qu'il serait un des hommes les plus distingués de son temps.
Il avait une charmante figure; ses traits étaient fins, et cela même remarquablement: chose étonnante, car sa physionomie n'est nullement active dans son expression, et pourtant rien n'est plus incisif que le regard de ses yeux presque atones, lorsqu'ils s'attachent sur vous avec une expression railleuse… Aimant vivement le plaisir, il trouvait le temps de tout accorder; et les matières sérieuses dont il s'occupa très-jeune encore prouvent qu'il ne passait pas ses journées à dormir, s'il passait ses nuits au jeu ou à souper avec des personnes joyeuses…
Sa force était, dit-on, une chose miraculeuse; il passait quelquefois deux et trois nuits de suite sans dormir; il lui fallait paraître le quatrième jour au matin avec toutes ses facultés sérieuses, eh bien! il dormait une heure après avoir pris un bain, et paraissait aussi dispos de corps et d'esprit que s'il sortait d'une retraite de six semaines à la Trappe. Une particularité qui tient à lui, c'est qu'avec cette force vraiment rare, il n'en avait pas la moindre apparence: il avait même plutôt celle d'une jeune fille… et son visage rose et blanc ne révélait en aucune sorte qu'il n'en fût pas une. Jamais M. de Talleyrand n'a fait sa barbe, et cela par une bonne raison: c'est qu'il n'en a pas, et n'en a jamais eu; il aurait pu, à vingt ans, jouer parfaitement le rôle de Faublas. Et, en y pensant bien, je croirais peut-être que Louvet a connu M. l'abbé de Périgord, et beaucoup de circonstances de sa vie de jeune homme. Voici un fait qu'il est, je crois, bon de conserver. Je pense que M. de Talleyrand ne l'a pas oublié.
Lorsque les jeunes abbés de qualité étaient au séminaire de Saint-Sulpice, ils avaient en Sorbonne un ecclésiastique comme répétiteur, ou pour une fonction à peu près semblable. Son nom, je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai jamais su. Je ne connais que son surnom, il s'appelait la grande Catau. Pourquoi? Voilà ce que je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que tous les jeunes abbés l'appelaient ainsi. Un jour, cet homme, plus animé par ce qu'il savait probablement, et par ses propres sentiments, se laissa emporter à une vive allocution en présence de huit ou dix de ces jeunes têtes destinées à porter la mitre et peut-être la tiare. C'était d'abord M. de Talleyrand; puis l'abbé de Damas, l'abbé de Montesquiou, l'abbé de Saint-Phar, l'abbé de Saint-Albin, l'abbé de Lageard, etc., etc.
– Oh! s'écriait-il dans un moment d'exaltation, oh! mon Dieu!.. qu'est-ce donc que je vois dans ceux de tes serviteurs destinés à faire aimer ta loi!.. que vois-je parmi eux… là-bas dans cet angle obscur2, parmi ceux destinés un jour à porter peut-être la couronne de saint Pierre, mais sûrement la mitre épiscopale… que vois-je?.. des hommes portant et propageant les vices du siècle parmi le clergé, parmi les serviteurs de Dieu!.. Oh! mon Dieu! mon Dieu! que deviendra donc votre sainte religion?..
La grande Catau était une personne de grand jugement et d'un esprit très-supérieur.
Quelques années plus tard, un autre homme apostrophait M. de Talleyrand d'une manière encore plus directe. Cet homme était M. de Lautrec, lieutenant-général, ayant une jambe de bois et le droit de parler au nom du pays. Il avait été de plus ami du père de M. de Talleyrand.
– Monsieur, lui dit-il le premier jour, à l'Assemblée Constituante, lorsque M. de Talleyrand passait devant le vieillard mutilé pour aller au côté gauche, où il siégeait; Monsieur, si M. votre père vivait, il vous mettrait les bras comme nous avons les jambes.
M. de Lautrec était un homme ayant le droit de parler ainsi.
Aimant la vie du monde d'autrefois, et telle que pouvait l'avoir un homme de sa condition et de sa qualité; aimant avec passion les femmes, le jeu, et tout ce qui constituait alors un homme à la mode, ce fut ainsi que 1789 trouva M. de Talleyrand. Il était trop habile pour ne pas comprendre que le vieil édifice croulerait peut-être bientôt: car il était violemment ébranlé. Aussi, une fois aux États-Généraux, prit-il le parti qui devait triompher. Les bénéfices dont il jouissait lui devaient être enlevés par la force des événements; et, selon lui-même, il convenait mieux de les abandonner le premier (je dis toujours peut-être). Sa conduite aux États-Généraux fut conséquente; elle le fut encore lorsqu'il se sépara pour faire partie de l'Assemblée lors de l'affaire du Jeu de Paume…; mais elle fut grande et belle lorsqu'étant évêque d'Autun il entra à l'Assemblée Constituante3. Il fut constamment très-brillant dans cette nouvelle carrière, et se signala avec un courage qu'en vérité on ne demande aux prêtres que pour le martyre: il proposa lui-même l'abolition des dîmes du clergé, démontra la nullité des mandats impératifs, et, une fois au Comité de constitution, il se montra plus véhément cent fois qu'aucun de ceux qui en faisaient partie avec lui. Un fait assez remarquable dans la vie de M. de Talleyrand, c'est que l'époque qui en est la plus importante dans l'intérêt du pays est sa carrière administrative: et c'est la moins connue précisément. Ce temps, déjà bien loin pour nous, qui ne regardons jamais au-delà des jours tout près de nous, est rempli de travaux importants. Avec la même vérité, on peut louer la conduite de M. de Talleyrand, lorsqu'il demanda que les biens du clergé fussent employés au soulagement du Trésor, alors tellement en souffrance, qu'on fut obligé de créer un papier-monnaie. M. de Talleyrand, en demandant que les biens du clergé fussent ainsi aliénés, faisait, certes, une belle et grande action, puisque ses bénéfices étaient son unique fortune. C'est une résolution noble et grande; et l'abbé Maury4 ne fut pas juste envers lui en l'attaquant comme il le fit. M. de Talleyrand provoquait une grande mesure qui pouvait sauver ou tout au moins aider à sauver le pays, si elle eût été appliquée dix ans plus tôt à ses besoins. – C'est donc une vérité incontestable que M. de Talleyrand fut utile à la France, et surtout voulut l'être; mais le torrent l'emporta.
On dit avec raison que l'Assemblée Constituante renfermait plus de talents et d'hommes d'esprit que la France n'en avait jamais vu rassemblés en un même lieu. M. de Talleyrand, quel que fût celui qui s'opposait à lui, paraissait toujours dans une attitude convenable et forte, et il est à remarquer que le côté gauche dont il faisait partie était formé des hommes les plus habiles de l'Assemblée… à quelques exceptions près qui se trouvaient au côté droit. L'abbé Maury, orateur à la Bossuet, se laissait emporter par la colère quelquefois, comme le grand homme de Meaux; cette colère l'aveuglait souvent, et alors il était inférieur à celui qui était en face de lui. C'est dans une circonstance semblable que M. de Talleyrand fut injustement attaqué par lui, lorsque, voulant prévenir des abus, il provoqua le décret qui ordonnait de mettre les scellés et de faire l'inventaire des effets mobiliers et immobiliers du clergé5… Ces deux hommes ont été peut-être plus opposés l'un à l'autre que Mirabeau et Maury, et pourtant on ne parle que d'eux. Il faut avoir étudié à fond cette époque pour savoir la vérité des choses. Mirabeau parlait beaucoup et bien; M. de Talleyrand parlait peu et mal… c'est-à-dire qu'il n'avait pas cette voix de tribune, cet accent du forum qu'avaient Mirabeau et l'abbé Maury; l'abbé Maury surtout, qu'on entendait bien autrement que l'évêque d'Autun, lorsqu'en pleine tribune il le signalait comme le chef de l'agiotage qui perdait, disait-il, les finances de la France plus que tout le reste… Dans cette lutte qui devint presqu'une dispute personnelle, l'abbé Maury fut souvent injurieux pour l'évêque d'Autun. Ce fut particulièrement en défendant tous les anciens droits du clergé et de la noblesse que l'abbé Maury fit autant de bruit. Il combattait pour un parti qui expirait, mais qui était encore nombreux, et regardait comme une tradition inviolable toutes les erreurs de l'ignorance, toutes les prétentions de l'avarice. M. de Talleyrand, quoiqu'il appartînt à cette caste qu'on attaquait, avait reçu la lumière hâtée par la civilisation; et plus éclairé que ses pairs, il s'était rangé du côté des opprimés qui réclamaient leurs droits… Il devait avoir raison.
Un jour que je raisonnais sur cette question avec le cardinal, il me dit:
– Est-ce que vous croyez aussi que la noblesse qui se sépara de ses frères au Jeu de Paume était de bonne foi tout entière?
– Pourquoi non?.. Sans doute, je le crois.
– Eh bien! vous vous trompez! cette bonne foi ne fut pas générale, et dans la plupart des grands seigneurs qui firent le premier noyau de l'Assemblée Constituante, le plus grand nombre voulait abaisser la puissance royale pour reconquérir cette autre puissance que Richelieu avait su détruire. Croyez-moi, un Montmorency se rappellera toujours qu'un Montmorency épousa la veuve de Louis-le-Gros6, et cette pensée ne lui fera pas venir celle de se faire Sans-Culotte. Le despotisme aristocratique était là, tout prêt à saisir les rênes aussitôt que la main du Roi les aurait laissées échapper… Les insensés ne voyaient pas qu'à côté d'eux était un tigre qui, dans sa gueule béante, devait engloutir et noblesse et royauté…
Ce n'est pas ainsi que pensaient plusieurs hommes qui, tout en ayant la possibilité de voir, ne voulaient rien apprendre du vocabulaire qui contenait le nom de leurs nouveaux devoirs envers le souverain; c'est ainsi qu'était M. le maréchal de Mailly. La figure de cet homme m'apparaît, en ce moment, lorsque je parle d'honneur et de gloire, et elle est demeurée silencieuse lorsque je parlais des victimes de Robespierre… Pourquoi cela?.. C'est qu'un être aussi honorable n'est jamais victime… Il ne meurt pas… et son nom lui survit pour proclamer le héros, l'homme de la gloire et non l'homme du supplice7.
Tout ce que l'histoire du temps et les Mémoires nous rapportent de la cour de Louis XIV, et de l'époque de la chevalerie, se retrouve dans le maréchal de Mailly.
Né en 1708, il avait passé sa jeunesse avec les hommes les plus distingués de la cour de Louis XIV. Il fit ses premières armes en Allemagne, sous le maréchal de Berwick et des officiers supérieurs choisis et élevés en grade par Louis XIV lui-même. Il reste encore beaucoup de personnes qui ont pu juger de la différence des manières dans les hommes de la Régence et ceux de Louis XVI dans la société, et elles peuvent dire qu'en effet la différence était grande. Le cardinal de Luynes, le maréchal de Croï, le duc de Richelieu, ont été connus par nos pères, et nous savons par eux comme la vie était douce et facile avec de telles personnes. Comme les relations étaient gracieuses! l'existence était du bonheur alors.
M. de Mailly avait toutes les idées du temps de Louis XIV; il voulait que tout le monde fût heureux, mais il avait horreur du mélange des classes. C'est ainsi que lorsqu'il alla gouverner le Roussillon (où sa mémoire est encore adorée), il ne voulut pas favoriser les académies; mais, en revanche, il donna des chaires d'enseignement dans les Universités. Dans le même temps, il fondait des hôpitaux, il ouvrait le port de Port-Vendres pour le peuple du Roussillon; et il établissait des manufactures, des foires, en demandant chaque année qu'on soulageât le peuple de ses taxes.
M. de Mailly avait un haut respect pour la noblesse; il aimait à raconter qu'il descendait d'Anselme de Mailly, tuteur des comtes de Flandre, qui commandait les troupes de la reine Richilde en 1070. Marié trois fois, il ne voulut jamais s'allier qu'à de grandes familles; sa dernière femme était mademoiselle de Narbonne-Pelet121. Il voulut connaître à fond l'histoire de la famille de Narbonne, et fut charmé d'apprendre qu'elle était excellente, et digne vraiment de ceux qui avaient été souverains de la ville de Narbonne par la grâce de Dieu.
Il fut très-content de la réponse que fit M. de Narbonne au Roi, lorsque celui-ci lui demanda, assez ridiculement, au reste:
– M. de Narbonne, êtes-vous Pelet?
– Oui, Sire…
– Et comment?
– Comme Votre Majesté est Capet.
Lorsqu'en 1770, le clergé fit des remontrances au Roi sur les écrits122 philosophiques, le maréchal de Mailly dit à un homme de ma connaissance: «La France aura une révolution plus sanglante que celle de l'Angleterre et de l'Allemagne. Mais sachez, monsieur, ajouta-t-il, que si jamais l'esprit du temps nous conduit à la nécessité de défendre le trône, nous mourrons tous avant le Roi!..»
L'époque prévue approchait à grands pas; et lorsque le premier prince du sang eut donné l'exemple à la noblesse, et que toute cette noblesse, soit d'action, soit de parole, eut laissé attaquer son principe vital, que la métaphysique du temps eut bien divisé sans classer, quand la jalousie et l'esprit d'égalité, amenés tous deux par le despotisme, eut renversé, confondu cette suite de dignités qui formaient et constituaient une grande monarchie, quand le maréchal de Mailly fut obligé d'ôter de son hôtel les armoiries si belles de sa famille:
Hogne qui vonra.
Alors il dit:
«On a peut-être mal fait, à Versailles, de trop peser sur cette classe qui triomphe aujourd'hui. Le cœur des Français est fier, sensible et peu endurant; on l'a humilié, il l'a senti, et il est demeuré vindicatif et ulcéré. Mais il y a dans la nation française quelque chose de grand que les insurgés ne savent pas faire (gouverner). Le tiers-état a renversé un heureux régime, mais celui qu'il lui a donné le renversera, car les Français sont actifs et industrieux; et, dans dix ans, vous verrez que la monarchie se relèvera plus forte et plus glorieuse.»
M. de Mailly ne s'est trompé que de deux ans dans ses calculs.
M. de Mailly ne voulut jamais émigrer; il était contre cette mesure, qui, en effet, laissa le Roi sans défenseurs… l'émigration en Angleterre surtout lui semblait une infamie. Ce fut le mot dont il se servit.
– Quand la Reine était puissante, disait le maréchal, l'Angleterre punissait le lord Gordon qui répandait des libelles contre elle. La Reine est malheureuse: eh bien! madame de Lamothe, fouettée et marquée par la main du bourreau, vend publiquement à Londres d'infâmes écrits sur la reine de France! Elle est accueillie à Londres! elle y est bien vue!.. Elle!.. madame de Lamothe!
M. de Mailly avait raison.
Louis XVI avait pour le maréchal de Mailly une profonde estime et une vénération qu'il est rare qu'un souverain ressente pour un sujet. Aussi ce fut lui qui fut chargé de la défense des côtes du Nord, lorsque le Roi fut averti que les Anglais, profitant des troubles du royaume, devaient faire une descente en France… Le quartier-général du maréchal était à Abbeville; il commandait depuis Montreuil jusqu'à Avranches.
Le maréchal de Mailly avait une grande estime pour une haute et belle naissance. Lorsqu'il fut nommé maréchal, il choisit pour ses aides de camp des hommes remarquables de ce côté: le premier était M. de Torelli, des comtes de Guastalla, maison ancienne, alliée à la France, au duc de Wurtemberg et aux princes d'Este; le second était M. d'Aubusson de la Feuillade, ambassadeur à Florence et à Naples sous l'Empire, et chambellan de Napoléon: un de ses aïeux avait été grand-maître de Rhodes; le troisième était le chevalier de Saint-Simon, descendant des anciens comtes de Vermandois.
Peu de temps après, le Roi partit pour Montmédy. Ce fut alors que la noblesse donna le coup mortel à sa position dans l'État; tout l'état-major de l'armée passa à l'Assemblée Nationale, les Liancourt, Montmorency, Choiseul, Praslin, Sillery, Castellane, de Luynes, Biron, Latour-Maubourg, Lusignan, Crillon, Crussol, Rochegude, Batz, Lafayette, Montesquiou, Menou, Beauharnais, Dillon, Lameth, etc.
Tous ces noms vinrent à la barre de l'Assemblée! La noblesse de France à la barre de l'Assemblée!.. dès lors, il n'y avait plus de monarchie.
Le maréchal de Mailly se conduisit alors comme on devait présumer qu'il le ferait. Lorsqu'il vit toute la cour de France à la barre, lorsqu'un événement aussi inouï, aussi scandaleux, eut prouvé que la royauté était morte en France, le maréchal de Mailly fit voir qu'il y avait encore un représentant des anciens serviteurs de saint Louis. Il envoya au Roi sa démission de toutes ses charges, et lui apprit que, dans sa monarchie expirante, il y avait encore quelques palpitations d'honneur, et que les vieilles maximes étaient moins versatiles que les emplois militaires n'étaient amovibles.
Quand je vois cette figure du maréchal, âgé alors de 83 ans, représentant à lui seul la monarchie française de saint Louis, de François Ier et de Henri IV, je suis d'abord attendrie, et puis mon cœur est rempli d'un sentiment profond d'exaltation et de généreuse admiration!
Il ne restait plus à l'ancienne France qu'un petit nombre de familles fidèles, et la monarchie constitutionnelle elle-même n'avait plus que des lambeaux déchirés par les factions; les haines avaient consommé ce que la confiante ignorance avait commencé. On appelait la seconde monarchie la monarchie des Feuillants, comme en Angleterre ils avaient donné un surnom ridicule à leur Parlement avant la mort de Charles Ier.
C'est ainsi qu'on arriva au 10 août. À minuit, le 9, le tocsin sonna; Mandat, qui voulait défendre le Roi, fut massacré à la Commune et son corps jeté à l'eau. Le maréchal de Mailly, apprenant que le Roi était sans défense, accourut aux Tuileries, se mit au milieu de sept à huit cents gentilshommes venus dans le même dessein que lui, et jura avec eux de mourir en défendant la famille royale. Le Roi passa la revue, et confia la défense des Tuileries au maréchal. Ce fut alors que la Reine, prenant un pistolet à la ceinture de Backmann, le donna au Roi en lui disant: Monsieur, voilà le moment de vous montrer. M. de Mailly salua le Roi de son épée, et lui dit: Sire, nous voulons relever le trône ou mourir à vos côtés!..
Le Roi se couvre, tire son épée, et jure de demeurer avec eux. Mais Rœderer entraîne le Roi à l'Assemblée; tout est fini, il n'y a plus de roi de France.
Quelques nobles suivent le Roi; d'autres se retirent… ce qui reste demande les ordres de M. de Mailly. Que pouvait-il faire? les canonniers étaient passés aux fédérés!.. il ne lui reste plus que la gendarmerie, commandée par Raimond.
– Vivent les grenadiers français! s'écrie le vieillard. – Vive mon général! répondent les grenadiers.
M. d'Affri, commandant des Suisses, avait répondu à la Reine que des Suisses ne pouvaient tirer sur des Français, et s'était retiré. Backmann et Zimmermann l'avaient remplacé… On connaît le détail de cette horrible journée. Le Roi envoya l'ordre aux Suisses de ne plus tirer, par M. d'Hervilly; l'ordre ne put parvenir au milieu du carnage et des malheurs qui commençaient ainsi la République, dont c'était le premier jour!..
Le maréchal, perdu dans cette foule qui combattait pour ainsi dire corps à corps, vit tuer à ses côtés M. de Pomard, gentilhomme qui était son aide de camp. Le noble vieillard, l'épée à la main, combattait toujours néanmoins comme un jeune homme plein d'ardeur; un homme lève sur lui un sabre rouge de sang et allait le tuer, le maréchal pose avec calme la main sur le bras de cet homme et se nomme; à l'aspect de cette figure vénérable, de ces cheveux blancs, de cet homme revêtu du cordon bleu et de ces insignes dont l'éclat imposait encore, le fédéré laisse tomber son sabre; puis, ordonnant tout bas au maréchal de se taire et de le suivre, il le maltraite, et, tout en l'entraînant, lui arrache son cordon bleu qui est toujours un honneur, mais aussi un signe de proscription… C'est ainsi que le maréchal fut conduit à son hôtel… le nom de cet homme est demeuré inconnu… alors une action généreuse était un crime!..
Deux jours après, le maréchal fut dénoncé et conduit à sa section. Ses nobles réponses, ses cheveux blancs et ses quatre-vingt-trois ans firent impression sur les monstres de 93, qui alors n'étaient encore qu'au berceau!.. Il échappa, et se retira avec la maréchale, toute jeune alors, dans le département du Pas-de-Calais. Là, André du Mont, altéré du sang des royalistes en 93, comme il le fut en 94 de celui des républicains, le fit jeter en prison; la maréchale ne le quitta pas… Joseph Lebon, qui succéda à André du Mont, fut assez cannibale pour envoyer à l'échafaud un homme aussi vénérable par son âge que respectable par sa chevaleresque loyauté. En approchant de l'échafaud, sa tête se releva plus fière que jamais elle ne l'avait été devant l'ennemi.
– Vive le Roi! s'écria-t-il… je le dis comme mes ancêtres!
Sa malheureuse femme était enceinte en 1792, et mit au monde, cette même année123, le fils124 qui devait transmettre à cette époque le beau nom de son père.
8.
M. de Talleyrand demeura constamment dans le parti de la Révolution, et le jour de la fameuse fédération il dit la messe au Champ-de-Mars… Le clergé non-constitutionnel fut doublement contre lui… L'abbé Maury l'attaqua avec d'autant plus de colère que, Mirabeau étant mort, il n'avait plus de quoi occuper assez directement sa bilieuse colère… Un jour il attaqua M. de Talleyrand, comme chef de l'agiotage qui avait un monopole impudemment établi dans Paris… M. de Talleyrand, qui voulait bien s'occuper de la chose publique, mais en repos pour lui-même, comprit cependant qu'un peu de tolérance dans le sens inverse serait une bonne chose… Il s'éleva contre l'émission des deux milliards d'assignats qu'on voulait créer et mettre en émission pour éteindre la dette publique; mais le cardinal ne lui donna pas la joie de pouvoir se vanter d'une mesure sage et modérée… Il fit de grandes railleries sur ces deux milliards:
– À quoi bon! disait-il… puisque la dette est de sept milliards?..
M. de Talleyrand, incapable de lutter contre un tel homme avec sa voix douce et sa figure toute féminine, se contentait de lui répondre de ces mots piquants dont au reste, quinze ans plus tard, le cardinal n'avait pas encore perdu le souvenir…
Ce fut alors que M. de Talleyrand fut nommé exécuteur testamentaire de Mirabeau… Déjà membre du département de Paris, ce qui le rapprochait beaucoup de Manuel et d'une foule d'autres noms qui appartenaient à la Révolution la plus intime de cette époque, M. de Talleyrand fut dès lors classé par ses anciens pairs dans la partie mauvaise de la Révolution… Il n'en était rien… M. de Talleyrand, comme bien d'autres, avait été entraîné le premier jour dans une route où le pied glissait aisément et où le retour, comme le temps d'arrêt, est également impossible; mais il avait un moyen, il l'employa: ce fut de quitter la France; il sollicita de faire partie de l'ambassade de Londres; il eut, dit-on, une mission particulière relative, ainsi qu'on le crut, à l'établissement des deux Chambres. M. de Chauvelin était notre ambassadeur à Londres9. Pitt était alors au ministère.
M. de Talleyrand avait fui la France, parce qu'on s'y méfiait de son civisme. – En Angleterre, il fut en butte aux soupçons de la plus intime malveillance, parce qu'on le crut jacobin. Ribbes, de la Chambre des Communes, le présenta comme attaché au parti d'Orléans… Ainsi M. de Talleyrand n'était ni royaliste pour les royalistes, ni républicain pour les hommes nouveaux, ni enfin quelque chose… En France, il fut compromis par l'affaire d'Achille Viard; et cité par Chabot, qui ne l'aimait pas, il somma Roland, alors au ministère de l'Intérieur, de le justifier sur ce rapport avec lui… Roland répondit, mais de manière à ne montrer aucune sympathie pour M. de Talleyrand. Aucun parti ne l'adoptait franchement. C'est alors qu'il alla en Amérique. Contraint de quitter l'Angleterre, effrayé des désordres qui se commettaient en France, il chercha un lieu où le retentissement de la tourmente révolutionnaire n'eût pas pénétré. On était alors en 1794: il se rendit aux États-Unis; c'est de là qu'il sollicita sa rentrée en France. Les jours de sang étaient passés, et remplacés par des jours, sinon plus glorieux, au moins plus paisibles. M. de Talleyrand fit demander sa radiation par quelques femmes dont il était fort aimé, et surtout madame de Staël, et il fut rappelé. Cela devait être sous un gouvernement comme celui du Directoire. Il y a plus: il fut ministre, et eut le portefeuille des Affaires étrangères.
Je viens de donner presqu'une biographie de M. de Talleyrand; c'est que pour arriver à lui à cette époque, si différente de celle où il avait passé sa vie, il fallait le montrer, non pas ce qu'il était (car qui peut dire ce qu'il fut, ce qu'il est, et ce qu'il sera!), mais son attitude dans le monde, sous le Directoire…
Cette attitude fut ce qu'elle eût été sous le cardinal de Fleury, si M. de Talleyrand fût né quarante ans plus tôt: celle de l'homme le plus spirituel de la société. Il connaissait le Directoire, le méprisait, et ne croyant plus (s'il est vrai qu'il y ait jamais cru) à cette belle liberté régénératrice qui avait assuré ses premiers pas dans la carrière politique révolutionnaire, il se conduisit en conséquence de cette nouvelle croyance. Dans la façon tout énigmatique dont il se pose, M. de Talleyrand donne peu de prise à ceux qui sont chargés, par goût ou par toute autre cause, d'écrire sur lui; il est lui-même un être à part… il étonne, intéresse parce qu'il amuse, mais n'attache jamais. Peu susceptible d'une sérieuse occupation, riant de tout avec cette amère ironie qui grimace en voulant sourire, M. de Talleyrand revint en France parce que l'Amérique l'ennuyait, et que dans le reste de l'Europe on ne voulait pas de lui: en Angleterre, M. Pitt le disait jacobin; en Allemagne, on ne l'aimait pas mieux: l'Italie n'était plus son fait. Quant à l'Espagne, un évêque excommunié aurait été rôti comme un marron en 1795, et ce cas était celui de M. de Talleyrand à l'époque dont je parle… Le Pape l'avait excommunié en 179110, à peu près à la mort de Mirabeau.
On le rappela donc; et, en arrivant en France, il trouva partout de l'intérêt pour lui, bien qu'il ne fût pas aimé. C'est qu'il y avait des femmes qui se mêlaient de ses affaires…; il les avait si bien servies dans sa jeunesse, qu'elles lui devaient leur secours…
Le général Lamothe, alors colonel et fort bien vu au Directoire (ce qui ne fut pas plus tard), lui servit d'introducteur le jour où il se présenta au Luxembourg. Je ne me rappelle plus qui en était alors le président… Lamothe était avec M. de Talleyrand, à qui il donnait le bras, parce qu'on sait que M. de Talleyrand n'a pas la démarche très-sûre; il s'appuyait donc, d'un côté, sur le bras de Lamothe, et, de l'autre, sur sa canne en forme de béquille, ou sa béquille en forme de canne, et ils cheminaient ainsi dans les vastes salles du palais directorial, lorsque, arrivés dans le salon qui précédait celui du citoyen président, l'huissier de la Chambre vint prendre la canne de M. de Talleyrand… Cette canne ou cette béquille était trop nécessaire à son maître pour qu'il s'en dessaisît; l'évêque la retint comme il l'aurait fait de sa crosse: mais l'huissier avait des ordres.
– Je ne puis laisser cette canne au citoyen, dit-il.
Monsieur de Talleyrand l'abandonna…
– Mon cher, dit-il à M. Lamothe, il me paraît que votre nouveau gouvernement a terriblement peur des coups de bâton…
Et cela fut dit avec cet air impertinemment insoucieux qu'il a toujours, et qui à lui seul est toute une injure quand il n'aime pas quelqu'un.
Madame de Staël l'aimait fort déjà ou encore à cette époque, je ne sais pas bien lequel des deux; son esprit actif et brillant devait pourtant trouver un grand mécompte dans cette positivité toute sèche et toute personnelle; mais, avec elle, l'esprit avait raison sur TOUT. Son âme se reflétait alors sur celle de l'autre, et lui communiquait sa chaleur momentanément… Madame de Staël allait donc fréquemment chez M. de Talleyrand, et M. de Talleyrand était un des habitués du salon de madame de Staël.
M. de Talleyrand, noble, évêque, révolutionnaire, après avoir couru les aventures, après avoir été ce que le duc de Lerme appelait un Picaro, et rentrant chez lui comme un homme simple et sans prétention, en avait pourtant une grande: il voulait entrer au Directoire. C'était bien permis; et, en vérité, l'ambition n'était pas grande, car ceux qui composaient ce gouvernement monstrueux, n'avaient pas entre eux cette homogénéité parfaite qui est si nécessaire pour produire l'unité de vues et d'intention11.
À l'époque où M. de Talleyrand fut appelé aux Affaires étrangères, il y avait un troisième parti qui n'était ni de ce qu'on appelait l'hôtel de Noailles12, ni de Clichy; c'était, si l'on peut se servir de ce mot, un dédoublement des constitutionnels… Ce parti était puritain dans ses principes, et affectait une régularité extrême; les plus influents étaient pour les Cinq-Cents, où surtout il dominait, Henri Larivière, Pastoret, Boissy-d'Anglas, Lemérer, Camille Jordan, Pichegru, Delarue, Demersan, etc.
Ce parti voulait le bien, mais moins peut-être que le parti constitutionnel, dont étaient Barbé-Marbois, Tronçon-Ducoudray, Mathieu Dumas, Bérenger, etc., etc… Sans doute il y avait des intrigants dans ce parti comme dans tout autre… mais il y en avait moins… Thibaudeau était du parti constitutionnel, et en parlant d'honnêtes gens dans ce parti-là, j'aurais dû le nommer le premier.
Les mesures révolutionnaires étaient rejetées par les deux partis que je viens de nommer… Celui qui les soutenait était le parti du Directoire: c'étaient Boulay (de la Meurthe), Jean Debry, qui fut ou ne fut pas assassiné à Rastadt, Poulain-Grandpré, Boulay-Paty, Chazal, Chénier surtout, etc… Ce parti n'était pas le plus fort en grands talents, quoiqu'il en eût plusieurs, mais il avait pour lui les armées et le Directoire.
Maintenant il y avait le parti royaliste, qui était bien fort aussi au milieu de cette anarchie… il se réunissait à Clichy; le Directoire l'exécrait. C'était un vrai club, une nouvelle représentation des Jacobins ou des Cordeliers; cette réunion fixait également l'attention publique, et surtout celle des contre-révolutionnaires.
Voilà comment allait la France politique au moment de l'arrivée de M. de Talleyrand au ministère. Il se trouva, de plus, qu'on dut renommer un directeur… Ses prétentions se réveillèrent… mais il ne fallait pas songer à prendre cette place… Trop de prétentions l'entouraient, et les Conseils, qui étaient pour beaucoup dans la nomination des candidats, ne voulaient pas d'un homme du Directoire. M. de l'Apparent fut écarté pour cette raison par Henri Larivière. On connaît son accent habituellement furieux… il s'élança à la tribune et s'écria:
– Tout homme qui a reçu des fonctions du Directoire est exclu de droit.
Et, un moment après, en entendant prononcer le nom du général Beurnonville pour la candidature, il s'écria de nouveau avec un redoublement colère:
– Non, il ne faut pas aller chercher des candidats dans la fange de 1793!..
Cette sortie presque indécente fut blâmée même par les amis de Henri Larivière…
Barthélemy fut le candidat adopté presque à l'unanimité; presque continuellement absent, étranger à la Révolution, il n'offusquait personne; il fut nommé, mais aussi fructidorisé peu de temps après.
M. de Talleyrand n'avait aucune de ces conditions, et n'eût été que plus tôt fructidorisé. Mais bientôt il comprit qu'à côté de lui était un remède à cette faiblesse d'abandon où il se trouvait; et les Clichiens devaient lui donner de l'espoir. Mais au milieu de ces luttes, comme il y en avait en ce moment, il était empêché et ne pouvait rien résoudre… Ce qu'il voulait quelquefois, c'était sa retraite. Un incident nouveau vint occuper sa vie.
Un jour, dans sa jeunesse, M. de Talleyrand, étant aux Tuileries avec un de ses amis du séminaire, il lui fit remarquer une femme qui marchait devant eux; elle était grande, parfaitement faite, et ses cheveux, du plus beau blond cendré, tombaient en chignon flottant sur ses épaules…
– Mon Dieu! quelle belle tournure! s'écria l'abbé de Périgord.
– Oui, dit l'abbé de Lageard; mais le visage n'est peut-être pas aussi beau que la tournure le promet.
Ils doublèrent le pas et dépassèrent la belle promeneuse; en la voyant, ils demeurèrent charmés: une peau de cygne, des yeux bleus admirables de douceur, un nez retroussé et un ensemble parfaitement élégant.
J'ai déjà dit que les grands-vicaires de Reims étaient des hommes à la mode mauvais sujets. On doit penser qu'ils voulurent savoir le nom de la belle blonde… Cela fut aisé.
Elle s'appelait madame Grandt.
– Son mari est bienheureux, dit M. de Talleyrand… Et comme il était occupé ailleurs en ce moment, après avoir payé le tribut d'admiration qu'on doit à une belle personne, il passa outre; seulement, quand il s'ennuyait, il pensait à la belle blonde…
Les années s'écoulèrent, M. de Talleyrand retrouva la belle blonde, et comme elle et lui n'avaient aucune occupation particulière, celle qui leur parut la plus convenable fut de se rapprocher… Soit que la belle blonde eût la seconde vue, soit qu'il lui convînt de donner son cœur à M. de Talleyrand, ce fut un arrangement convenu et conclu13…
Une autre femme, qui se croyait lésée, peut-être avec raison, par cet arrangement, jeta les hauts cris, et menaça même M. de Talleyrand de sa vengeance; mais elle était bonne et ne sut jamais se venger… elle ne savait même pas punir une offense…
Des affaires plus graves se mettaient à la traverse de tout ce qui était repos et plaisir, malgré la soif que chacun avait de se satisfaire après un jeûne aussi long… Les Conseils devinrent des arènes où chaque parti se mettait en bataille devant l'autre. Le 30 prairial an V, il y eut une lutte dans l'Assemblée qui faillit dégénérer en combat; on ôta au Directoire la surveillance et l'autorisation des négociations que faisait la trésorerie nationale. Le lendemain, un député de Maine-et-Loire (Leclerc) demanda le rapport; il parla de la lutte continuelle qui existait entre les commissions et le Directoire… Aux premières paroles qu'il prononça, il y eut un seul cri poussé par cent voix, et tous les Clichiens se portèrent sur lui à la tribune… Les partisans du Directoire y coururent pour le défendre. Les combattants en vinrent à des voies de fait, et les coups les plus violents furent portés. Malès, un député, fut terrassé par un autre (Delahaye), qui le saisit à la gorge et lui déchira ses vêtements. Pichegru, qui était président, ne pouvait pas venir à bout de cinq cents hommes!
Il y avait sans doute de grands malheurs à cette époque; mais le plus grand était cette désunion entre les différentes opinions. M. de Talleyrand, ennuyé de ce qu'il voyait, regrettait presque l'Amérique et les séances de l'Assemblée Constituante, même celle du Jeu de Paume… Ce fut au milieu de ces agitations que le 18 fructidor eut lieu.
Un fait certain, c'est le peu d'influence que dans le commencement M. de Talleyrand a eu sur le Directoire… il cherchait à sonder le terrain… Tous les hommes qui l'entouraient étaient plus habiles que lui pour diriger cette révolution intègre et politique qui promettait à la France de succéder à l'autre.
Pendant que les Conseils prenaient des résolutions, le Directoire, qui faisait le roi depuis quatre ans et qui y prenait goût, le Directoire était au moment de faire un coup d'état. Poussé à bout par les Conseils, il voulait reconquérir l'autorité qu'il avait su prendre sur eux. Talleyrand connaissait-il les projets du Directoire? Je l'ignore… Il y avait alors une telle méfiance entre tous les partis qu'on ne savait ce qu'on devait faire ni penser.
Augereau arriva à Paris, envoyé de l'armée d'Italie par Bonaparte; il trouva l'esprit public partagé dans les opinions. Tout ce qui tenait à l'armée était en fureur contre les Conseils. Kléber et Bernadotte déclamaient contre eux sans dissimuler leur sentiment. Le feu n'avait plus sur lui que des cendres bien légères pour l'empêcher d'éclater.
Schérer était alors au ministère de la Guerre, comme M. de Talleyrand au ministère des Affaires étrangères: c'étaient le talent et l'impéritie; c'est une telle union qui fit que le Directoire ne sut jamais à temps que sa perte était le but des divers mouvements. Il fallait qu'il s'unît avec les Conseils, et tout eût été sauvé pour le Directoire; mais le Directoire lui-même était alors présidé par Laréveillère-Lépaux, qui fulminait dans des discours contre les Conseils, n'agissait jamais… et jouait à la chapelle pendant ce temps-là de manière à faire rire de lui. Voilà comment était la France à cette belle époque, qu'on prétend la seule de la liberté.
Kléber, dînant un jour chez Schérer dans le commencement du mois de fructidor, dit hautement que le gouvernement militaire était le seul qui convînt à la France. Bernadotte l'appuya, et dit encore après lui quelques mots qui prouvaient combien leurs sentiments étaient contraires aux Conseils. Des députés qui dînaient aussi chez Schérer, mais qui étaient dans le parti neutre, tremblèrent néanmoins pour leur corps… car c'était ici comme avec les parlements… Du reste, les discours de Laréveillère-Lépaux, prononcés à l'occasion de je ne sais plus quelle fête, et contre l'armée autant que contre les Conseils, étaient une maladresse inouïe.
L'éloignement du parti royaliste des Conseils était, comme on le sait, le motif du 18 fructidor. Ce parti, qu'il fallait punir, mais non pas retrancher, ne fut qu'un moyen dont le Directoire se servit pour mutiler l'assemblée. Si le parti royaliste eût vraiment alarmé le Gouvernement, il n'aurait pas fait grâce à M. de Talleyrand, qui était en renommée, depuis son retour, d'être royaliste et de protéger les émigrés.
Bernadotte était alors ami de Bonaparte; du moins, en avait-il l'apparence. Il lui écrivait le 7 fructidor:
«Le parti royaliste n'ose plus heurter de front le Directoire, il a changé de plan; mais, selon moi, il n'en doit pas moins être conspué et poursuivi, afin que les patriotes puissent diriger les prochaines élections. Cependant, il y a des craintes qu'une commotion mal dirigée ne devienne funeste à la liberté, ET QU'ON NE SOIT OBLIGÉ DE DONNER AU DIRECTOIRE UNE DICTATURE MOMENTANÉE. Je ris de leur extravagance. Il faut qu'ils connaissent bien peu les armées et ceux qui les dirigent, pour espérer de les museler avec autant de facilité…
«Ces députés qui parlent avec tant d'impertinence sont loin d'imaginer que nous asservirions l'Europe SI VOUS VOULIEZ en former le projet.»
Bernadotte ajoutait qu'il partait du 20 au 25. Ce séjour d'intrigues ne lui convenait pas, disait-il à Bonaparte.
«Adieu, mon général, jouissez délicieusement, n'empoisonnez pas votre existence par des réflexions tristes. Les républicains ont les yeux sur vous, ils pressent votre image sur leur cœur; les royalistes la regardent et frémissent.
«Malgré les tentatives de Pichegru et compagnie, la garde nationale ne s'organise pas. Cette espérance des Clichiens tombe en quenouille. Je vous envoie la déclaration de Bailleul à ses commettants.»
Cette lettre, qui est textuellement transcrite, est fort remarquable par la confiance que Bernadotte paraît avoir dans son allié14, et, d'un autre côté, elle fait voir aussi que les royalistes comptaient sur l'opinion publique, puisqu'ils voulaient la garde nationale. C'était le 13 vendémiaire renouvelé; les sections étaient la garde nationale.
Celle que la Reine aimait tant, et qui avait été sa dame d'atours; fille du comte de Périgord, frère de l'archevêque de Reims, elle était belle-fille du maréchal.
Après le 18 fructidor, on voulut mettre un autre général à la place de Carnot, et on fit dire au général Lefebvre (plus tard le duc de Dantzick) de venir et qu'il serait nommé.
Sa femme, après s'être fait lire la lettre, car je crois qu'elle ne savait pas lire, dit à son mari:
«Reste ici; qu'iras-tu faire là-bas? Il faut qu'ils soient bien malades pour avoir besoin d'un imbécile comme toi!.. Reste ici et ne va pas donner ta tête ou ta liberté; laisse les manteaux rouges s'arranger entre eux.
Il écouta les conseils de sa femme, et fit bien.